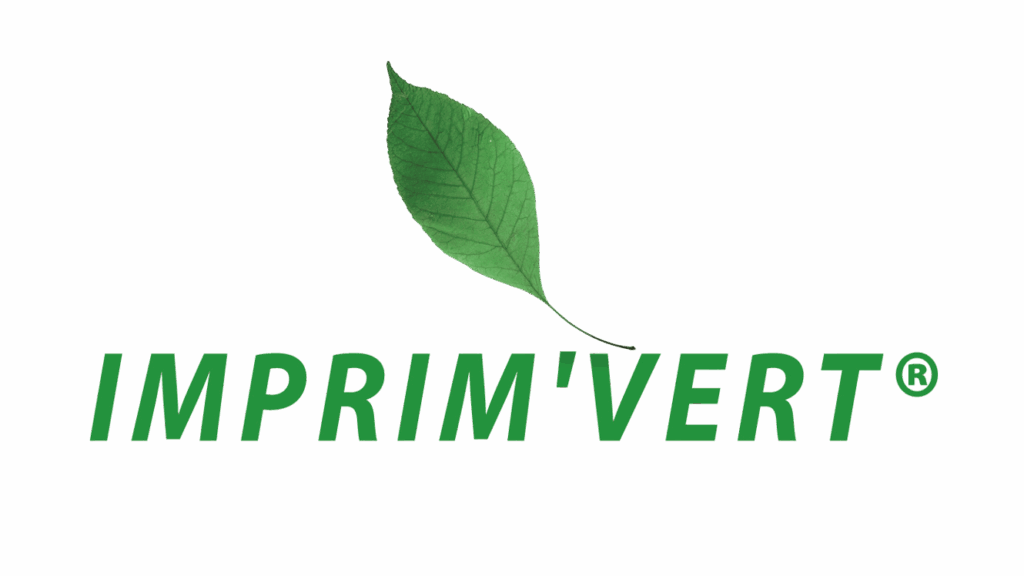Fouler le sol d’un festival, ouvrir le programme d’un concert, recevoir un billet en main propre : autant de gestes familiers pour tous les amateurs d’événementiel. Pourtant, derrière chaque ticket, chaque décor, chaque déplacement d’artiste ou de spectateur, se cache un impact réel sur la planète ; un impact bien souvent invisible mais qui mérite toute notre attention.
Sommaire
ToggleChaque événement, aussi festif soit-il, ajoute sa part à une empreinte carbone globale qui ne cesse de croître. Ce constat bouscule les habitudes du monde de la culture et de l’impression : peut-on continuer à célébrer la rencontre, la créativité et le partage, tout en préservant l’environnement ? Jusqu’où repenser nos pratiques, nos choix de supports, nos modes de production sans sacrifier l’exigence artistique ni la qualité de l’expérience ?
Des chiffres qui interpellent
La première étude ministérielle sur l’empreinte carbone de la création artistique française révèle des données surprenantes. Le secteur culturel représente 1,3% des émissions de CO₂ de la France, soit le double du transport aérien intérieur, alors qu’il ne pèse que 2% du PIB national. Cette disproportion met en lumière l’urgence d’une transition écologique dans un domaine jusqu’alors peu scruté sous cet angle.
L’étude, menée par la Direction générale de la création artistique (DGCA) en collaboration avec PricewaterhouseCoopers, s’appuie sur l’analyse d’une centaine de bilans carbone pour extrapoler les données à l’ensemble du secteur. Christopher Miles, directeur de la DGCA depuis 2021, a fait de cette démarche une priorité.


Le spectacle vivant en première ligne
Le spectacle vivant se positionne largement en tête du classement des émissions avec 7 millions de tonnes équivalent CO₂, contre seulement 1,3 million pour les arts visuels. Cette hiérarchie s’explique par la nature même de ces activités : tournées, déplacements du public, infrastructure technique lourde.
Les opéras figurent parmi les plus gros émetteurs. L’Opéra de Paris génère à lui seul 42 800 tonnes de CO₂ annuelles, soit presque autant que les 78 scènes nationales réunies. De son côté Opéra-Comique, plus modeste, émet 1 000 tonnes. Un théâtre lyrique produit en moyenne 2 726 tonnes équivalent CO₂, soit trois fois plus qu’un fonds régional d’art contemporain et quatre fois plus qu’un centre dramatique national.


Comprendre les sources d'émissions
L’étude révèle des résultats contre-intuitifs. Les consommations énergétiques ne représentent que 10% de l’empreinte carbone des arts visuels et 9% pour le spectacle vivant. Ce constat relativise l’impact des bâtiments, contrairement aux idées reçues.
Pour le spectacle vivant, ce sont les déplacements du public qui constituent le premier poste d’émissions avec 38% de l’empreinte totale. Dans les arts visuels, cette proportion grimpe à 65% et peut varier en fonction l’accessibilité des lieux : le Centre international d’art de Vassivière ou les Rencontres d’Arles, qui attirent un public international, génèrent plus d’émissions liées aux transports que le Crédac d’Ivry-sur-Seine, accessible en transports en commun.
Les achats (matériaux pour décors, costumes et accessoires) constituent un autre poste majeur pour le spectacle vivant.
Dans les écoles d’art, c’est le bâti qui représente 28% des 30 000 tonnes de CO₂ émises annuellement.
Notre approche responsable de l'impression événementiel
Face à ces enjeux environnementaux, Hermieu, spécialiste de l’impression pour l’événementiel, a développé une approche écoresponsable qui privilégie les billets papier traditionnels plutôt que les solutions électroniques.
Cette position s’appuie sur des données factuelles concernant l’impact environnemental comparé. Les data centers, infrastructure nécessaire aux billets électroniques, représentent désormais 46% de l’empreinte carbone du numérique en France, soit 4,4% de l’empreinte carbone nationale. Un e-mail avec un ticket dématérialisé génère 5 grammes de CO₂, contre 2 grammes de CO₂ pour un ticket papier traditionnel.
Nous mettons tout en œuvre pour répondre aux enjeux d’écoresponsabilité en évitant la pollution numérique associée aux data centers et aux envois d’emails massifs. Notre démarche d’impression responsable privilégie l’utilisation de papier issu de forêts gérées durablement et avec des fibres 100 % recyclées et l’adoption de pratiques d’impression respectueuses de l’environnement. Nous démontrons ainsi qu’il est possible de concilier besoins événementiels et responsabilité écologique.

Initiatives et solutions émergentes
Plusieurs autres structures pionnières montrent la voie. Le Festival d’Aix-en-Provence pratique l’écoconception de ses décors depuis 2014. Le festival parisien We Love Green a réduit ses émissions de 500 tonnes entre 2022 et 2023 grâce à une restauration 100% végétarienne et n’émet plus que 1 000 tonnes de CO₂. Le Festival interceltique de Lorient assure sa logistique avec des vélos-cargos. Le Festival d’Avignon (4 500 tonnes de CO₂) expérimente le transport ferroviaire pour ses décors et renforce l’offre de transports en commun en soirée.
Ces exemples illustrent les leviers d’action possibles : rallonger la durée de vie des spectacles, généraliser le réemploi, standardiser les châssis de décors, encourager les circuits courts.
Défis et perspectives
L’objectif fixé est ambitieux : réduire les émissions de 50% d’ici 2030. En 2023, seulement 51% des structures labellisées avaient engagé une démarche de transition écologique, et à peine un quart du personnel était formé à ces enjeux.
Le ministère prévoit une écoconditionalité douce des subventions et demande aux opérateurs de définir des objectifs, mesurer leurs émissions et former leurs équipes. À ce titre, un outil d’estimation du bilan carbone sera déployé cet automne.
Cependant, la rénovation des bâtis nécessitera des investissements conséquents, dans un contexte budgétaire contraint, illustrant le dilemme entre fin du mois et fin du monde.